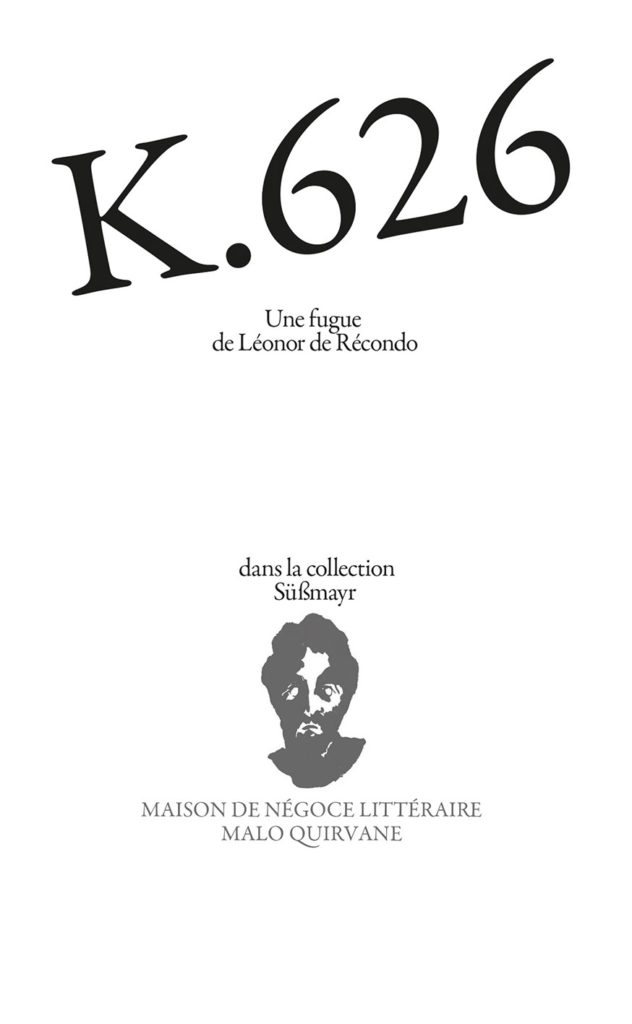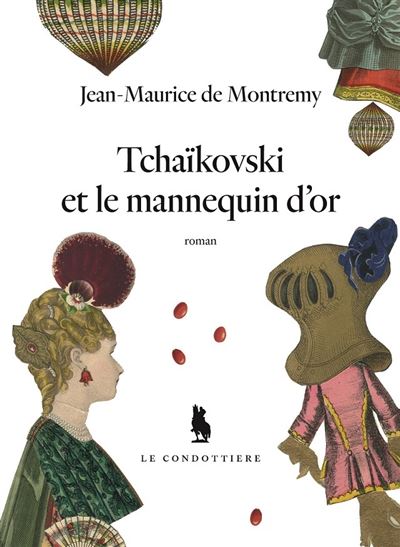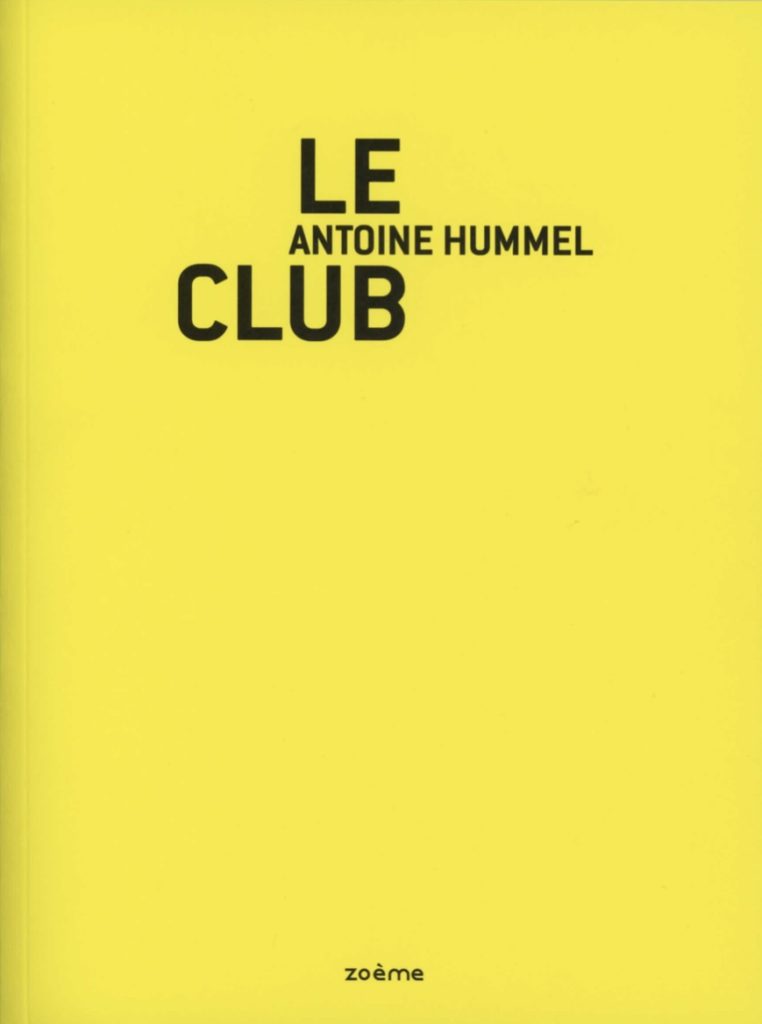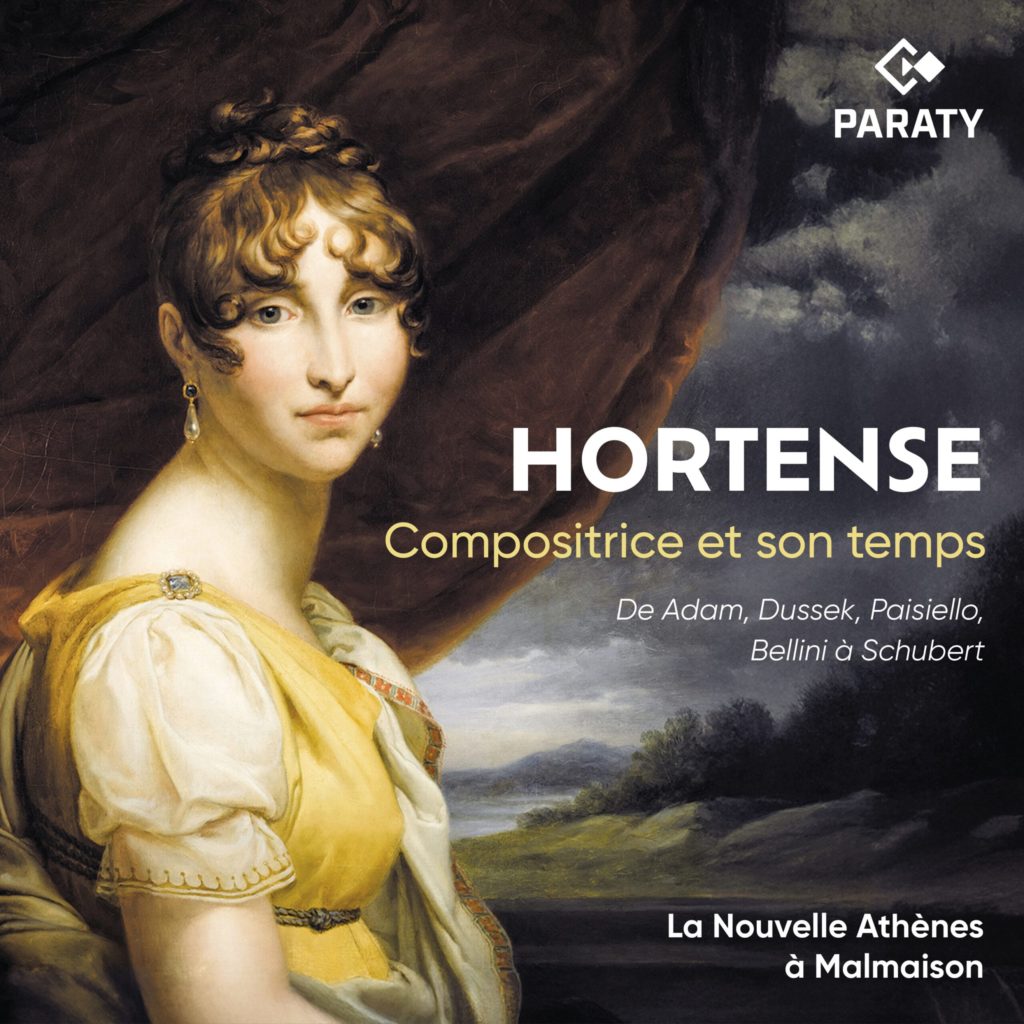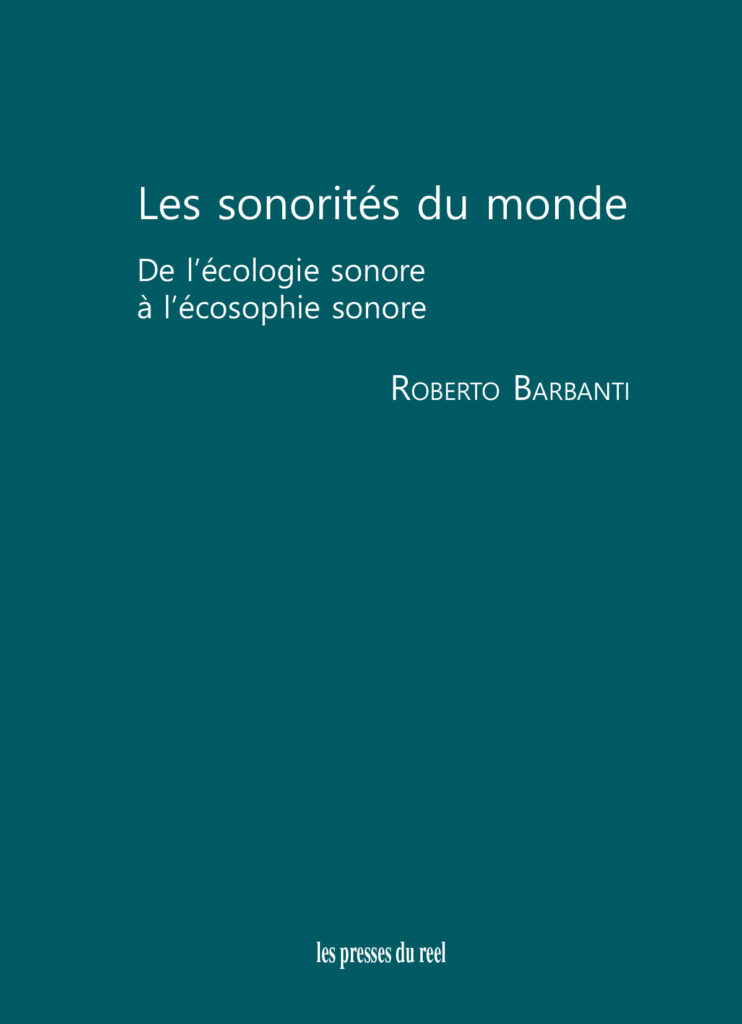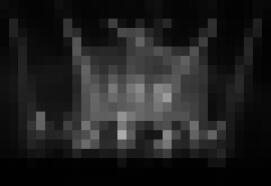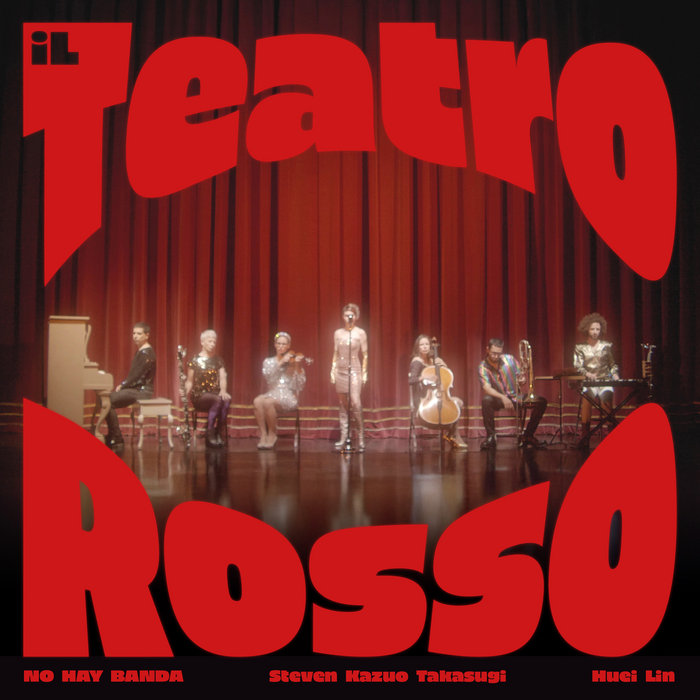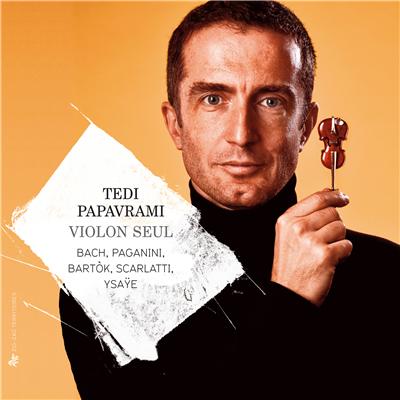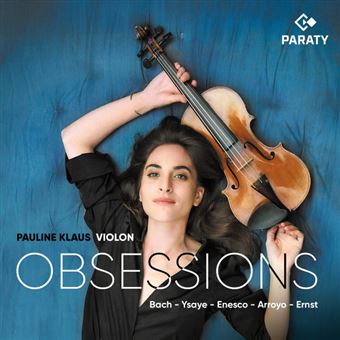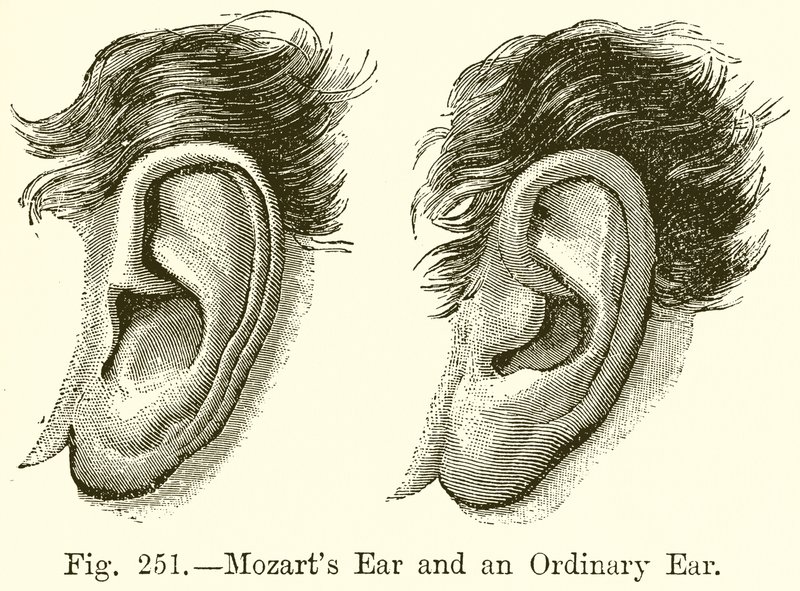
En lisant Ma vie, l’autobiographiede Wagner, le musicologue John Deathridge se demandait s’il ne faudrait pas faire un livre qui mettrait en parallèle le récit affabulé que le compositeur a fait de sa vie et un récit plus factuel et historiquement exact de ce qui est vraiment arrivé. Avec Carl Dahlhaus, John Deathridge pense que Wagner a volontairement romantisé son œuvre dans l’espoir de romantiser sa vie et que son autobiographie aide même à établir des parallélismes entre Wagner et les épreuves traversées par les personnages de Tristan et Isolde. S’il paraît comme une évidence que les autobiographies ont toujours eu une part d’autofictions, il reste à voir jusqu’où la littérature peut venir compléter l’histoire de la musique.
Pour ce numéro « Supputer » de Metaclassique, nous recevons Leonor de Recondo qui a signé K. 626 aux éditions Malo Quirvane et Jean-Maurice de Montrémy qui a publié le roman Tchaïkovski et le mannequin d’or chez Le Condottière, deux ouvrages qui installent la création littéraire dans certains angles morts laissés par l’histoire de la musique et qui tendent à montrer qu’au lieu ou en plus d’une diversion à la réalité des faits, la fiction pourrait offrir quelques compléments d’information sensibles sur la vie de grands compositeurs.
Une émission supposée et explicitée par David Christoffel.
Podcast: Play in new window | Download